No CrossRef data available.
Published online by Cambridge University Press: 14 February 2024
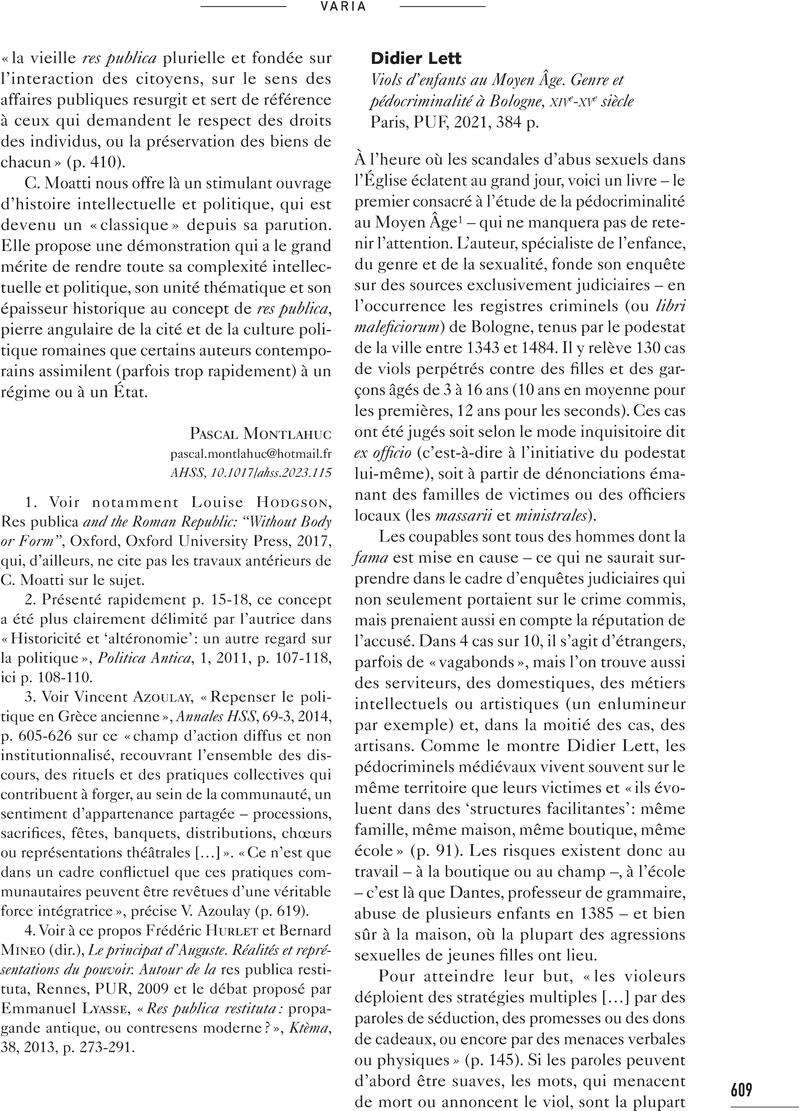
1 Encore qu’il faille mentionner le livre récent de Dyan Elliott, The Corrupter of Boys: Sodomy, Scandal, and the Medieval Clergy, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2020, qui étudie les « same-sex relations » dont celles entre hommes adultes et garçons, mais en milieu clérical uniquement (monastères, chœurs, écoles cathédrales, cours épiscopales).
2 Mario Sbriccoli, « Justice négociée, justice hégémonique. L’émergence du pénal public dans les villes italiennes des xiiie et xive siècles », in J. Chiffoleau, C. Gauvard et A. Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2007, p. 389-421.
3 Jacques Chiffoleau, « Dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du xiie au xve siècle », Annales ESC, 45-2, 1990, p. 289-324.